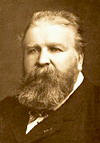MUSIQUE AU LOUVRE
sous le Second Empire
par Philippe LUEZ
Conservateur au Musée national
du château de Compiègne
|
Les salons embourgeoisés de la Monarchie de Juillet avaient découvert la musique autour de 1835 : ceux des comtesses Merlin ou Apponyi, de la princesse Belgiojoso ou de madame Orfila. Le Siècle recense 884 concerts pendant le carême 1838, et une moyenne de 35 concerts par jour pendant le mois d'avril 1840. Pendant cette période, les plus grands virtuoses, Chopin, Liszt, Paganini, Kalkbrenner, se fixent à Paris, où ils viennent chercher une consécration. La rage des soirées mondaines reprend avec l'arrivée au pouvoir du Prince-Président et se poursuit pendant tout le Second Empire. Désormais, ce sont surtout les salons des principaux dignitaires du régime qui donnent le ton: celui de Fould, de Walewski, de Morny, d'Haussmann; l'un des plus remarqués pour la qualité de ses prestations musicales est celui du comte Emilien de Nieuwerkerke, Directeur général des Musées nationaux puis impériaux, de 1849 à 1870, intendant puis surintendant des Beaux-Arts de la Maison de l'Empereur, et amant déclaré de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III. A la tête du Louvre depuis un peu plus d'un an, Nieuwerkerke avait découvert dans le personnel de la Maison de l'Empereur un jeune musicien, Jules Pasdeloup. Ancien élève de Zimmermann, premier prix de piano du Conservatoire en 1834, Pasdeloup était entré dans l'administration en avril 1848 et occupait le poste de régisseur du Palais de Saint-Cloud. Dès 1851 et jusqu'en 1870, Nieuwerkerke le charge d'organiser chacune des auditions musicales, les fameux "vendredis", donnés au Louvre en général pendant le carême. Le salon devient rapidement trop étroit pour un public d'habitués toujours plus nombreux. L'acoustique est médiocre, notamment à cause des tapisseries de Beauvais qui couvrent les murs, et on fait construire une estrade pour le piano en février 1854 pour essayer de corriger ces carences. Les travaux d'achèvement du Louvre par Lefuel forcent le directeur à fermer son salon en 1857. Les soirées reprennent avec un prestige accru, le 22 janvier 1858. Dans le nouvel appartement de fonction, le cabinet du directeur s'ouvre directement sur la salle des pastels, récemment décorée par Deruelle, annexée chaque vendredi de carême pour les soirées du maître des lieux, au grand scandale de certains chroniqueurs et journalistes du temps. Le déroulement d'un "vendredi" au Louvre est maintes fois décrit par ceux qui y sont conviés: la soirée commence tôt, dès 7 h et finit tôt, vers 11 h. Le comte de Nieuwerkerke fait les honneurs avec une bienveillance unanimement saluée, en donnant à chacun, note Le Ménestrel le 19 mars 1864, "une de ces cordiales poignées de main que son affabilité personnelle rend si douce et si précieuse". Biard le représente ainsi dans son tableau Le Salon de M. le comte de Nieuwerkerke (1855), conservé au Musée national du Second Empire à Compiègne, serrant la main de l'architecte Visconti, prématurément disparu en 1854. On rencontre aux soirées du Louvre "le monde officiel comme celui des arts, des lettres et des sciences". C'est une société exclusivement masculine, à l'exception, à partir de 1858, des artistes, instrumentistes ou cantatrices, qui seules seront admises. " Puis, vers 10 heures, M. Pasdeloup, qui est l'impresario du lieu, se met au piano [ ... 1. M. le comte de Nieuwkerke (sic) se place à la tête du public en imposant le plus profond silence avec une autorité de religion pour les arts qui commande tout." Le programme musical de la soirée est toujours présenté comme court, mais de grande qualité: " c'est plutôt, note Le Ménestrel du 22 mars 1863, un intermède musical pour reposer des conversations qu'un concert qui appelle l'entracte pour reposer de la musique. " L'hôte donne souvent le signal des applaudissements. "Entre chaque morceau, les conversations, la promenade et le buffet font intermèdes et diversion." La collation comporte sans doute plus que trois bouteilles de sirop, une brioche, deux livres de petits gâteaux et du thé, comme le prétend l'atrabilaire Viel-Castel dans ses Mémoires. La soirée se termine habituellement par "l'arrière soirée", réservée à un petit nombre de privilégiés, au cours de laquelle le peintre Charles Giraud exécute les caricatures des familiers du maître de maison. L'amphitryon s'est toujours défendu d'être plus qu'un amateur éclairé: "J'aime la musique sans être musicien" se plaît-il à dire de lui-même. Mais, c'est souvent vers lui que se tournent bon nombre d'artistes en quête de protecteurs. Il soutient avec une constante fidélité Théodore Ritter, Ernest Reyer et Jules Cohen, qui devient chef de la musique de la chapelle des Tuileries. Il figure également parmi les personnalités conviées à l'une des premières auditions des Troyens de Berlioz en 1858.
|
Dès l'origine des "Vendredis du Louvre", Jules Pasdeloup (1819-1887) fait jouer au Louvre les jeunes élèves du Conservatoire. C'est ainsi qu'on entend le jeune Bizet, présenté par son maître Marmontel, en décembre 1852. Pasdeloup, pianiste brillant, a pu jouer certaines de ses compositions, comme Aurore, valse de concert, écrite dans le goût superficiel et brillant de ce milieu du XIXe siècle. Mais Pasdeloup invite également les plus grands noms de l'époque: Tolbecque, Roger, Duprez, Lefébure-Wély ou Mme Norman-Neruda, à qui Nieuwerkerke envoie sa voiture les soirs de concerts au Louvre. Gounod vient régulièrement, commente certaines œuvres du programme et accompagne parfois lui-même certaines de ses mélodies.
Né
à Hambourg, après avoir étudié la composition à Vienne, puis auprès
d'Halévy à Paris, Jacques Blumenthal (1829-1908) se fixe à Londres au
moment de la révolution de 1848. Invité au Louvre à chacune de ses
tournées en France, il y crée plusieurs de ses pièces pour piano.
Le Grand Trio, opus 26, publié à Paris en 1853, à une époque où
Jacques Blumenthal envisage d'y revenir, est probablement donné alors
au cours d'une soirée au Louvre.
Comme lors des fameux Concerts populaires, dont il est le responsable à partir de 1861, Jules Pasdeloup fait souvent preuve d'audace dans les programmes qu'il propose au Louvre en 1851, il fait entendre aux invités un nouvel instrument, le saxophone. Régulièrement, on y entend l'orgue-mélodium du facteur Alexandre, petit harmonium de salon créé vers 1845, seul ou en formations de chambre. C'est pour cet instrument que le jeune Jules Cohen écrit, en 1855, ses Six études expressives qu'il dédie à Nieuwerkerke, et qu'il interprète lui-même le 1er février 1856. Elève d'Halévy qui l'avait fait entrer au Conservatoire, il avait déjà obtenu un premier prix de solfège en 1847, de piano en 1850, d'orgue en 1852 et de composition en 1854. Issu d'un milieu financier aisé, il renonce à passer le prix de Rome, mais obtient, en contrepartie une classe au Conservatoire qu'il gardera jusqu'en 1890. Cohen est régulièrement présent aux Soirées du Louvre, et s'y fait entendre, soit au piano soit à l'orgue-mélodium. Il écrit de nombreuses pièces pour cet instrument, seul ou en formation de chambre, comme le Trio sur la "Resistenza", Canzone de Stradella, sur une harmonisation de son maître Fromenthal Halévy. En mars 1866, Georges Bizet exécute au Louvre plusieurs de ses compositions. A la fin des années 1860, Camille Saint-Saëns (1835-1921), alors au fait de sa carrière de pianiste virtuose, tient régulièrement le piano et joue en duo avec le violoniste Sarasate. Introduit, sans doute grâce à l'appui de Nieuwerkerke auprès de la princesse Mathilde, il lui dédie en 1864 sa Sérénade, opus 15, pour piano, violon, violoncelle et orgue-mélodium. Amateur passionné de musique allemande, à laquelle il consacre une large part des concerts de la Société des jeunes artistes, qu'il fonde en 1852 et dont Nieuwerkerke accepte la présidence en 1855, Pasdeloup fait jouer notamment les quatuors d'Haydn, le Septuor de Beethoven ou la Sonate pour violoncelle et piano, de Mendelssohn, exécutée en avril 1867 par Piatti et Saint-Saëns, œuvres encore assez méconnues à l'époque. Pasdeloup établit des programmes à peu près identiques pour les salons de la princesse Mathilde et du baron Haussmann dont il est également chargé. En mars 1862, le journaliste de l'AlIgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig constate avec étonnement la vogue sans égale de la musique allemande à Paris, non seulement aux concerts populaires, mais aussi dans les principaux concerts et soirées privées. Pasdeloup, fort de l'appui du comte de Nieuwerkerke, a pu créer une véritable mode, venant prendre le relais du goût pour la musique italienne. Par la volonté de son directeur, le Louvre apparaît, pendant tout le Second Empire, comme un lieu de concert recherché tant des artistes que des amateurs, comme un des plus importants centre de création musicale en France pendant vingt ans, annonçant le renouveau de l'école française de musique de chambre après 1870. |
|
François-Auguste BIARD: Le Salon du Comte Alfred Emilien de Nieuwerkerke
|
||
|
|
Dans un lieu habité comme le château de Compiègne, la musique occupe une place privilégiée. Aux souvenirs sensibles des souverains qui y ont séjourné, de Louis XV à Napoléon III, ou de leurs hôtes prestigieux, le tzar Alexandre 1er, l'Empereur François-Joseph et bien d'autres, se mêlent ceux, plus immatériels, des concerts, fanfares et opéras dont l'édifice a retenti à leur intention. Les airs de la Bergère châtelaine d'Auber jouée au " petit théâtre" du château répondent aux cantiques du mariage de Louise d'Orléans ou à l'impertinent quadrille de Barbe-Bleue d'Offenbach au cours d'une série de 1865. Aujourd'hui encore, la présence de musiciens dans tel ou tel salon vient offrir au public des moments privilégiés où se mêlent contemplation de décors, plaisir musical et réminiscences de moments de l'histoire. Pour la réalisation de cet enregistrement, à l'occasion de l'exposition Le Comte de Nieuwerkerke ; art et pouvoir sous Napoléon III, le château de Compiègne a retenu des œuvres caractéristiques du Second Empire: le Grand trio de Blumenthal, inconnu du grand public, méritait à lui seul les honneurs du disque et la Sérénade de Saint-Saëns surprendra par l'originalité de la formation musicale. On y découvrira la Paraphrase de Stradella de J. Cohen, dont on ne connaît que le manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de France, et la brillante Valse de salon de Pasdeloup, qui met en lumière un aspect méconnu du talent du fondateur des Concerts populaires. Ces quatre pièces, fruit d'importantes recherches menées par Philippe Luez, conservateur au Château de Compiègne et enregistrées ici pour la première fois, nous transportent, le temps d'une soirée, dans le célèbre salon du Surintendant des Beaux-Arts de Napoléon III au Louvre, et permettent de mieux comprendre comment le talent des artistes qui l'ont fréquenté et animé en ont fait un des hauts lieux de la vie musicale sous le Second Empire.
Jacques Perot Directeur du château de Compiègne
|
|
|
Le salon du Comte de Nieuwerkerke: Art et pouvoir sous Napoléon III Exposition au Château de Compiègne 6 octobre 2000-8 janvier 2001
|